LA
DONATION DE CONSTANTIN
Le document baptisé "Donation de Constantin" représente
le faux le plus célèbre de la Papauté. Il fut critiqué
à maintes reprises, mais l'analyse la plus acerbe et la plus complète
fut certainement celle rédigée en 1440 par l'humaniste italien,
Lorenzo Valla. Les qualités littéraires de son ouvrage lui
valurent, après sa mort, un Siège de Maître dans la
demeure apollinnienne des Muses, comme le dit son épitaphe; nous
nous devons de reconnaître ici sa liberté d'esprit et son courage
pour avoir dénoncé, à son époque, ce qu'il faut
bien désigner comme une imposture.
Les Institutions monastiques, et particulièrement les Etablissements
fondés directement par des Rois comme Saint-Denis en Gaule, usèrent
abusivement, jusqu'à la fin du XIIème siècle, pour
la défense de leurs intérêts matériels, de l'arme
en leur possession quasi exclusive: l'écriture; son caractère
"sacré" rendait vrai tout ce qui était écrit.
Ces moines surent profiter des changements profonds apportés, à
partir du VIIIème siècle, par la minuscule caroline, qui permit
aux copistes de travailler beaucoup plus rapidement qu'antérieurement
avec l'onciale ou semi-onciale, et favorisa le développement de la
ponctuation, de la mise en page, de la division d'un texte en chapitres
etc... Cette révolution technique rendit, en contrepartie, progressivement
illisibles les manuscrits anciens, notamment mérovingiens, que ces
grandes Institutions possèdaient dans leurs scriptoria-bibliothèques.
En fonction des nécessités du temps, des rapacités
humaines dévoilées, quelques moines antiquisants et lettrés
utilisèrent ces parchemins, devenus inutiles puisque illisibles,
après les avoir lavés, comme supports de textes fabriqués
pour la défense de leurs Etablissements, en donnant faussement une
origine royale à leur possession de territoires, terres ou immeubles;
par exemple, la fausse "Donation de Dagobert" à Saint-Denis. |
LORENZO VALLA

|
La "Donation de Constantin", supposée
avoir été rédigée en 315, apparaît dater
très vraisemblablement de la période où Etienne II
séjourna à l'abbaye royale de Saint-Denis durant les quatre
premiers mois de 754, afin d'obtenir de Pépin le Bref les concours
armés nécessaires à la défense du Patrimoine
de Saint Pierre contre les entreprises des Lombards. Reconnaître la
souveraineté de droit de l'Evêque de Rome, sur l'ancien duché
dont il était pratiquement propriétaire, constituait pour
Pépin une démarche logique, compte tenu de la défaillance
totale de l'ancien Suzerain, l'Empereur d'Orient. Attribuer en outre à
Etienne II d'autres possessions comme Ravenne et les villes de l'ancien
Exarchat byzantin ne pouvait se faire qu'au vu d'un acte de propriété
autorisant leur restitution à leur supposé patron, l'Evêque
de Rome, stipulé héritier de l'ancien Empereur Constantin.
Cet acte de propriété pouvait être produit devant les
Lombards, qui tenaient ces territoires par droit de guerre. L'écrit
s'affirmait comme une preuve intangible. L'utilité de la fausse "Donation
de Constantin" amena les fonctionnaires de l'Administration pontificale
à donner au document une valeur juridique indiscutable, et à
le placer dans les collections canoniques pseudo-isidoriennes, les fausses
décrétales réalisées en Gaule vers le milieu
du IXème siècle "source lointaine de 300 citations dans
les annotations du Code de droit canonique de1917"(1)
Finalement, la fausseté de la "Donation de Constantin"
fut officiellement admise en plein XIXème siècle, au moment
où l'Eglise avait perdu toutes ses possessions terrestres, ce qui
ôtait tout intérêt au document On voit là, clairement,
l'intervention de l'Esprit-Saint promouvant le mensonge et l'imposture pour
la défense de son Eglise romaine "sainte" et "divine".
(1) -Cf. Dictionnaire historique de la Papauté
-Editeur Fayard -Paris Page 669.
|
CONCLUSION
II LES PREMIERS TEMPS
DE L'ETAT PONTIFICAL
(754-1054 )
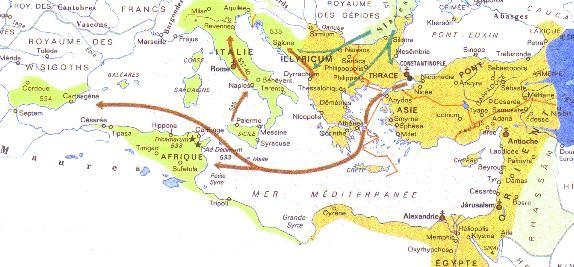
L'Empire Romain d'Orient dans sa plus grande extension,
après les reconquêtes ( 537-550 ) de Justinien Ier
SOMMAIRE
1 L'EFFACEMENT PROGRESSIF DE L'EMPIRE D'ORIENT
2 ETIENNE II -HERITIER DE CONSTANTIN
3 L'ETAT
PONTIFICAL JUSQU'AU SCHISME D'ORIENT
1 L'EFFACEMENT PROGRESSIF DE L'EMPIRE D'ORIENT
Après sa victoire sur Maxence au Pont Milvius
le 28 Octobre 312, Constantin fit ériger au centre de Rome, durant l'hiver
312 -313, une statue équestre le représentant portant le labarum,
qui proclamait triomphalement son caractère d' ''Auguste", de béni
de Dieu. Il s'était déjà déclaré Pontifex
Maximus en 307; sa statue équestre signifiait clairement son origine
divine. C'était la première fois qu'un Empereur d'Occident s'affichait
ainsi, mais Constantin fut rapidement imité par son grand rival en Orient,
Licinius. En 324, Constantin devint le seul maître de l'Empire dans sa
globalité, après l'élimination de son rival.
La révolution politique intervint en 325,
lors de la création de l'Eglise catholique et apostolique à Nicée,
par la déclaration solennelle de l'unicité de Dieu; en conséquence,
l'Empereur devenait, non pas le "béni" d'un des dieux de l'Olympe,
mais le seul "béni" du seul Dieu. L'Eglise néo-chrétienne,
christianisée, eut pour tâche de diffuser le nouveau culte dans
tout l'Empire, ce qui devait renforcer son unité. Nous avons précédemment
signalé les monuments édifiés durant la vie de Constantin,
dieu solaire éclairant de ses rayons jusqu'aux extrêmités
de ses possessions.
La question se posait toutefois de la poursuite
de cette action ecclésiale après la mort de son fondateur. Celui-ci
devança les difficultés en dotant richement son Eglise de biens
fonciers importants pour lui assurer en toute circonstance les ressources nécessaires
à la diffusion de son culte, célébré dans des basiliques
construites sur des terrains appartenant personnellement à l'Empereur,
et à Rome hors des murs de la Ville. Ce culte le statufiait post mortem
en une hypostase céleste du Pouvoir; on adorait désormais le Christ-Constantin
en tant que "Empereur céleste et Seigneur de Majesté".
Contentons-nous de rappeler que "Christos", adjectif de la langue
grecque, ne se confond pas avec "Chrestus", nom de personne latin;
il ne peut s'appliquer qu'à un Roi ou Empereur et non à un prédicateur
galiléen, fut-il thaumaturge, ou à Dieu lui-même puisque
c'est lui qui bénit; il ne lui servirait à rien de se bénir
lui-même. La religion néo-chrétienne, le christianisme,
s'établissait comme la religion du Pouvoir, et devait obtenir les concours
les plus richement dotés de la part des successeurs de Constantin et
des personnes exerçant une autorité plus ou moins étendue.
Au fil des siècles, l'Eglise, spécialement l'Eglise romaine, devint
un propriétaire foncier très important, et en conséquence
un acteur politique d'autant plus influent que l'Empire, après 476, s'éloigna
progressivement de Rome et de l'Italie. La conclusion naturelle fut,dans le
temps, la reconnaissance officielle de l'Eglise romaine en tant qu'Etat par
la puissance politico-militaire la plus importante d'Europe occidentale, en
la possession du Roi carolingien Pépin le Bref.
L'on peut résumer comme suit les relations
entre Rome et Constantinople:
Après la proclamation du Royaume d'Italie par Odoacre en 476, l'Empire
d'Orient suscita contre lui une action d'envergure des Ostrogoths conduits par
Théodoric en 488; celui-ci réussit à éliminer Odoacre
en 493. Théodoric s'établit à sa place à Ravenne
où il se manifesta comme un grand roi, tout en cultivant une méfiance
rancunière à l'égard des familles romaines de l'ordre sénatorial;
c'est ainsi qu'il accusa Boèce de trahison et le fit exécuter
en 524. La mort de Boèce précédée de la rédaction
de sa "Consolation philosophique" devait marquer la fin de l'Antiquité
Tardive et la naissance du Haut Moyen-Age.
Le royaume ostrogoth de Ravenne se maintint après le décès
de Théodoric en 526, jusque dans les années 550. Justinien en
527 devint Empereur à Constantinople et décida en 535 la reconquête
de l'Afrique du Nord aux mains des Vandales, et de l'Italie.
Bélisaire commanda les diverses expéditions qui aboutirent à
la destruction du royaume ostrogoth, l'envoi en exil à Constantinople
de ses dirigeants dont Cassiodore, et l'établissement à Ravenne,
à partir de 550, d'un Exarque ou Vice-Roi, représentant l'Empereur
de Constantinople. Les opérations politico-militaires s'étaient
terminées sous la direction de Narsès, qui avait remplacé
Bélisaire. Pratiquement, l'Exarque n'eut aucun moyen d'action alors qu'il
eut à lutter dès 568 contre les envahisseurs lombards. Ces derniers
firent refluer les Orientaux sur Ravenne et quelques points de la côte
adriatique. Dans le climat d'anarchie qui s'en suivit, le seul adversaire résolu
avec lequel les Lombards traitèrent fut l'Evêque de Rome, le pape
Grégoire Ier. dit le Grand.
La situation devint encore plus critique au siècle suivant du fait des
invasions musulmanes après 632. L'ancien Empire romain avait définitivement
disparu. L'Empire d'Orient se réduisit à l'Asie Mineure, la Grèce,
le Sud des Balkans, et temporairement à des possessions en Sicile et
Italie du Sud. L'Exarchat de Ravenne, lui, se réduisit de fait à
une appellation, d'autant qu'en 636 les Lombards avaient envahi le Frioul, la
Ligurie et Gênes. La ville de Constantinople eut à soutenir directement
les attaques des Musulmans en 674 -678. A l'avènement du VIIIème
siècle, les Empereurs byzantins acceptèrent la nouvelle situation
et abandonnèrent leur rêve de rétablir l'ancien Empire;
l'usage du latin cessa à Constantinople et l'Imperator devint Basileus.Profitant
de ces circonstances, dès 712, le Roi des Lombards Liutprand chercha
à unifier l'Italie à son profit; le Roi Astolf en 749 prit l'Exarchat
de Ravenne et les territoires qui lui étaient encore rattachés;cette
dernière action devait laisser face à face les Lombards et le
Pape de Rome, dont l'élection était affranchie depuis 731 de l'approbation
de l'Empereur byzantin. Comme celui-ci n'avait depuis longtemps aucune possibilité
d'affronter les Lombards, le Pape Grégoire III, en 739, sollicita par
trois lettres le secours de Charles Martel; mais en vain, puisque ce dernier
était l'allié des Lombards. L'envoi d'un reliquaire contenant
de la limaille des clés et chaînes de Saint Pierre n'obtint aucun
résultat.
Entre-temps, quelle avait été l'évolution
de la ville de Rome?
Aux yeux des théologiens romains, le règne de Constantin apparaissait
comme "l'avènement du Royaume de Dieu sur Terre" (1)
.Même si la Ville n'était plus depuis le début du IVème
siècle le lieu du domicile des Empereurs, elle restait pour ses habitants
la Capitale de l'Empire, Caput Mundi. L'anarchie militaire qui règna
de 235 à 284 l'avait vidée d'environ un quart de sa population,
qui, à l'arrivée de Constantin, comptait à peu près
900.000 personnes au lieu de 1.200.000 au IIème siècle. En outre,
une série de catastrophes survint à partir du Vème siècle,
notamment le sac de la Ville en 410 (et peut-être aussi en 412) (2),
l'invasion des Huns en 452, puis les saccages des Vandales en 455 et de Ricimer
en 472. Au siècle suivant, l'invasion des Lombards ne fit qu'accélérer
le processus de dégradation déjà fortement engagé.
De surcroît, la malaria ravagea la Campagne romaine, bientôt suivie
d'épidémies de peste et de choléra; survinrent alors les
crues du Tibre, dévastant la Ville, inondant les terres cultivables ,
amenant des famines. Le tissu social de la Ville était menacé
de destruction, les familles nobles fuyaient à Constantinople ou à
Ravenne. Ces événements dramatiques eurent des conséquences
démographiques malheureuses: la population se réduisit à
500.000 habitants en 452, 100.000 au début du VIème siècle,
puis 90.000 après l'invasion des Lombards (3).
A l'époque de Grégoire le Grand, la Rome impériale était
en ruines, dans un état de délabrement insoupçonnable,
mais Rome subsistait. Les rues principales et les places étaient dégagées,
quelques aqueducs fonctionnaient encore et les moulins à eau du Janicule
fournissaient toujours leur énergie. Le commerce sur le Forum était
très ralenti certes, mais il y avait toujours des esclaves à acheter.
La Ville, chef-lieu du duché de Rome byzantin, abritait des cohortes
de fonctionnaires grecs, qui finalement travaillaient sous les ordres du Pape.
Celui-ci, en tant que propriétaire d'immenses domaines, situés
en Sicile, Sardaigne, Italie du Sud et Italie Centrale, sauva les Romains en
assurant non seulement l'approvionnement de la Ville par l'institution des diaconies,
mais aussi l'entretien des bâtiments utilisables et la construction de
nouveaux édifices. L'Evêque de Rome, et d'abord Grégoire
Ier., maintint les structures économiques, sociales et politiques de
la Ville dont il devint de facto le chef. Les possessions de l'Eglise romaine,
outre les domaines situés dans le Sud, s'étendaient d'un seul
tenant barrant toute l'Italie Centrale des côtes de la Méditerranée
à celles de l'Adriatique. L'Eglise était à cette époque
le propriétaire foncier le plus important de toute la Péninsule;
compte tenu de la vacance du Pouvoir byzantin, son rôle politique s'en
trouva effectivement renforcé, car elle était obligée de
se substituer pratiquement à l'Autorité impériale défaillante.
Des éléments de natures diverses vinrent s'associer pour "ressusciter"
Rome, Caput Mundi; même si le Monde se réduisait à l'Italie
puis à l'Europe Occidendale.
- D'une part, la
situation, ô combien dramatique et désespérante de la Ville,
provoqua en compensation des phénomènes socio-psychologiques analogues
à ceux que connurent très antérieurement les Juifs de l'exil
à Babylone. L' abomination de la situation déclencha, pour surmonter
le désespoir, la croyance en une certitude eschatologique, celle de la
résurrection de la Rome impériale; une croyance de cette sorte
fut aussi celle des "archéo-chrétiens" assurés,
en leur temps, de leur revanche finale sur les propriétaires romains
vaincus par leur Sauveur, qui viendrait, enfin, établir ses élus
dans un régime de bonheur parfait.Ces sentiments d'une croyance continue
en la "résurrection" de la Ville en tant que Capitale impériale,
étaient partagés par tous y compris son Evêque.
- D'autre part,
l'inefficacité totale de l'Autorité byzantine renforça
ces rêves de grandeur retrouvée puisque les actions du Pape, et
spécialement les accords de trêve passés entre Grégoire
1er et les Lombards (cette trêve devait se prolonger jusqu'au milieu du
VIIIème siècle), ces actions démontraient à chacun
le pouvoir de son Evêque, et que la Ville disposait encore de ressources
suffisantes pour réduire les conséquences des catastrophes.
En quelque sorte, les Romains pensaient déjà: Italia (Roma) fara
da se.
- Mais enfin, rien
n'aurait pu se concrétiser si Rome n'était devenue entre-temps
la Ville de Pierre, et du fait des Missions envoyées successivement en
Angleterre et en Allemagne, le centre spirituel ou mieux "le Centre magique"(4)
de l'Occident. La prise de Jérusalem par les Musulmans en 638 mit fin
pratiquement aux pélerinages en Terre Sainte. Rome s'érigea, selon
Bède le Vénérable, en "Lieux Saints" de l'Occident.
La vie de Pierre, fondateur supposé de l'Eglise romaine et porteur des
clés du Ciel, ne repose sur aucun fait historique. Les "Actes d'Apôtres"
ne mentionnent aucun voyage de Pierre à Rome. C'est l'hagiographie connue
sous le nom de "Liber pontificalis", qui indiqua un séjour
de Pierre à Rome dans les années 42 à 67 de notre ère.
Les "Actes" ne disent rien de la vie de Pierre après la réunion
qui aurait été tenue à Jérusalem avec Paul au sujet
de la circoncion; or cette réunion est présentée postérieurement
à la mort spectaculaire d'Hérode Agrippa 1er. en l'an 44. Quant
au contenu du "Liber Pontificalis", il suffit de rappeler le jugement
de Mgr. Duchesne : "C'est à la querelle de Symmaque et de Laurent
(en 514) que nous devons le "Liber Pontificalis" , un recueil de biographies
des papes". Il y eut au moins deux versions de ce livre. La première
ne relate plus que la vie de Symmaque avec la fin de celle d'Anastase. La seconde
a été compilée:
"par une personne
peu qualifiée pour faire de l'Histoire sérieuse. Jusqu'à
la fin du Vème siècle c'est un mélange bizarre de renseignements
puisés à bonne source, de légendes et de fantaisies
diverses L'auteur est un clerc de condition inférieure; il nous présente
les choses comme les pouvait voir un homme du peuple. C'est ce qu'on appelle
le Liber Pontificalis" (5).
Le peuple romain, comme tous les autres peuples en masses illettrées,
était taraudé par la peur de vivre: les peurs des invasions et
d'être capturé et vendu comme esclave; les peurs des abominables
épidémies et des maladies, des inondations du Tibre rendant la
terre incultivable et amenant les famines, les peurs de la foudre, du feu ravageur,
sans oublier le bruit des voix éoliennes dans les arbres, et tant d'autres
craintes qui rendaient la vie si difficile à supporter. Toutes ces peurs
conditionnaient si fortement les pensées et la conduite des hommes, qu'ils
créaient nécessairement pour les compenser une imaginaire Surréalité,
gage de paix et d'un bonheur final malgré les désespoirs de la
vie quotidienne. Cette Surréalité naissait dans les imaginations,
comme un fruit de l'inconscient collectif et individuel; elle s'exprimait par
la voix de ses "prophètes" et prêtres qui, en professionnels
du "divin" , proclamaient ce qu'il fallait croire et faire pour être
sauvé, détaillaient les rituels du culte approprié, et
décrivaient précisement la lutte éternelle engagée
par cette Surréalité, désignée par Bien, contre
ses ennemis occupés à perdre les hommes en se camouflant sans
cesse sous les attraits du plaisir.
A Rome, la légende de l'apôtre Pierre
semble s'être développée à dater de la fin du règne
de Marc-Aurèle, vers 180. Les restes supposés de Pierre auraient
été enterrés sous un "Trophée" décrit
à la fin de ce second siècle par un prêtre nommé
Gaïus. Quoi qu'il en soit, la Depositio martyrum Romae, dont la rédaction
remonterait à l'année 336, précise que le culte de Pierre
et Paul daterait de l'année 258. Le culte des martyrs, le commerce consécutif
inimaginable de reliques -ossements, les foules de pélerins se rendant
à Rome" ad sanctos" pour obtenir leur aide en telle ou telle
circonstance concrétisaient la religiosité des masses néo-chrétiennes.
La basilique Saint Pierre fut édifiée par Constantin, hors les
murs, sur le cimetière le plus important de la Rome antique; la basilique
accueillit, donc, les restes mélés de chrétiens et "païens";
elle fut inaugurée selon.J.Carcopino (6)
le 18 Novembre 350 après avoir reçu les restes dits de Pierre.Mais
peu après elle était assiégée par une foule de pélerins,
attirant avec eux une armée de mendiants.
Peut-on supposer une imposture de la part
des évêques de Rome et des auteurs ecclésiastiques reconnus,
célébrés comme Bède le Vénérable?
Vraisemblablement non. Grégoire 1er. était si persuadé
de la lutte incessante du bien contre le mal, et de la nécessité
de solliciter la divine providence pour chasser les maladies ou faire refluer
les eaux du Tibre, qu'il organisait fréquemment,dans la Ville, des processions
propitiatoires, exprimant ainsi ses croyances profondes.
Comme un élément déterminant
de la pratique religieuse d'alors, il faut souligner l'influence puissante du
monachisme occidental, de son rêve d'instaurer une vie angélique
sur terre par une continence absolue, conduisant un moine à guerroyer
sans cesse contre lui-même, et lui rendant impossible l'acceptation d'autrui
dans sa différence tant il était persuadé de sa supériorité
(angélique), élément de sa volonté de puissance. La
sévérité exagérée des pratiques monastiques,
particulièrement une ascèse excessive et dangereuse pour l'équilibre
humain, conférait à leurs discours un caractère normatif,
qui faisait d'eux les intermédiaires de choix entre la Surréalité
imaginée dans l'Absolu et le commun des mortels. Les monastères,
heureux possesseurs de reliques authentifiées par la naïveté
et la crédulité populaires, devenaient des centres d'attraction
pour les foules fidèles. Nobles, manants et esclaves vinrent y chercher
remèdes à leurs souffrances et à leurs peurs par le truchement
de dotations et offrandes diverses dont l'accumulation établissait ces
institutions, à l'instar des établissements romains, en coffres-forts
de l'Occident. Ces dons accumulés soulignaient la nature de fécondateur
du Christ néo-chrétien et rétablissaient la pratique millénaire
du contrat païen: " Je donne pour que tu donnes" Plusieurs moines
devinrent membres éminents de l'Administration pontificale. Plusieurs
moines devinrent évêques de Rome, comme Grégoire Ier. Leur
action encadra l'épanouissement de la religiosité et des superstitions
populaires, nées des peurs antiques devant le déroulement de la
vie. La religion néo-chrétienne n'avait pas été
divinement révèlée mais humainement fabriquée.
Un événement significatif de la
prise de conscience par l'Evêque de Rome de son pouvoir grandissant consista
dans l'organisation des Missions, dès le Pontificat de Grégoire
Ier., vers l'Angleterre puis ensuite l'Allemagne par Boniface, pour diffuser
le culte romain, sa théologie et ses rites. Cette action s'étendit
sur un long temps et signala clairement la volonté de l'Evêque
de Rome d'étendre son influence et celle de son Eglise bien au-delà
des limites de ses propriétés. Il y avait là une manière
non déguisée de "ressusciter", sous une forme nouvelle,
l'antique Empire occidental. L'Eglise romaine, principalement, avait été
fondée pour répandre le culte du Christ-Empereur jusqu'aux limites
de l'Empire. L'Orient s'étant détaché, il incombait aux
Papes romains de rétablir, grâce au nouveau culte, l'Empire d'Occident.
Enfin, le moment vint pour le Roi le plus puissant
d'Occident, Pépin le Bref, de reconnaitre le pouvoir politique et temporel
du Pape romain, en transformant en 754 et 756 le patrimoine de Saint Pierre
en véritable royaume.
2 ETIENNE II -HERITIER
DE CONSTANTIN
Le Pape Grégoire III mourut en 741, après
l'échec de sa demande d'aide à Charles Martel. Son successeur,
Zacharie, forte personnalité dotée d'une éloquence persuasive,
entama immédiatement des négociations avec le Roi lombard Liutprand,
qui aboutirent en 742 à la signature, à Terni, d'une paix de 20
ans, et à la restitution à Rome des patrimoines situés
dans les territoires annexés les années précédentes
par les Lombards. Liutprand décéda au début de l'année
744, et fut remplacé par Ratchis; celui-ci renouvela la paix de 20 ans
conclue entre le Roi défunt et Zacharie. Mais, "touché par
la grâce", en 749, le Roi Ratchis abandonna son trône pour
une vie monastique au Mont Cassin. Son successeur fut le Roi Astolf (Aistulf).
Ce dernier reprit le dessein de Liutprand d'unifier l'Italie à son profit.
Il envahit rapidement Ravenne et les villes dépendantes, chassa l'Exarque
et mit fin pratiquement à la présence de l'Empire grec en Italie
du Nord. Le Pape Zacharie, mort en 752, fut remplacé par Etienne II.
Astolf commença par discuter avec lui, puis manifesta ses prétentions
sur le duché de Rome qui faisait encore partie nominalement de l'Empire
byzantin; il réclama au Pape un tribut calculé à raison
de un sou d'or par habitant.
Le dilemme se posait à Etienne II de savoir s'il choisirait d'être
annexé ou non par les Lombards. Sur un plan strictement "religieux"
il ne semblait pas y avoir de réelles difficultés car les Lombards
s'étaient déjà convertis au Christianisme romain, et la
piété de leurs rois et nobles se manifestait par de nombreux dons
aux monastères et églises. Sur un plan de politique générale,
Etienne II, en tant que chef spirituel de l'Occident, et Maître véritable
du duché de Rome, ne pouvait accepter de devenir un sujet lombard.
- D'une part,
Rome se rêvait plus que jamais en Caput Mundi.
- D'autre
part, la Ville avait pratiquement rompu avec l'Empire grec dès 726, à
l'occasion de la guerre des images, et l'élection du Pape était
désormais affranchie de l'approbation de l'Empereur; Constantinople
restait malgré son éloignement une puissance plus imposante que
celle des Lombards.
- Enfin, le
successeur des Apôtres Pierre et Paul ne reconnaissait pas d'autre Maître
que le Christ-Empereur, et ne pouvait obéir à un roi "barbare"
qui devait recevoir par son intermédiaire personnel les lois "christianistes".Etienne
II se considérait comme un souverain à Rome, le successeur d'Auguste
et de Constantin.
La situation s'envenima à partir
de l'automne 752. Les Lombards multiplièrent les pillages dans la Campagne
romaine et les vols de reliques dans les églises situées hors
les murs de la Ville. Durant l'hiver 752 -753, le Pape fit succéder les
prières et les processions derrière une image "achiropoïète"
du Sauveur, c'est-à-dire non faite de main d'homme. Entre-temps, il avait
sollicité une intervention militaire des Grecs, mais en vain. "Que
les Romains s'en tirent comme ils pourraient !". Cette réponse brutale
conduisit l'intéressé à se tourner, une nouvelle fois après
Grégoire III, vers les Francs.
Les Francs étaient chrétiens romains depuis Clovis, depuis deux
siècles et demi; Rome avait à plusieurs reprises noué des
relations avec eux. L'Empire romain ayant disparu, il apparaissait clairement
aux Princes francs que la Ville était le Siège de l'Autorité
religieuse à laquelle ils obéissaient, sous peine d'encourir de
graves dangers personnels: Pierre était non seulement le fondateur de
l'Eglise romaine, mais le "portier" céleste; il fallait donc
suivre ses commandements si l'on voulait gagner post mortem le lieu du bonheur
divin. La même crédulité règnait dans les Cours franques,
anglo-saxonnes, bavaroises !
En même temps qu'il intervenait en vain
auprès de Constantinople, Etienne II avait secrètement entamé
des pourpalers avec Pépin le Bref. Il désirait se rendre auprès
de ce dernier, et lui demandait de l'envoyer prendre et d'assurer son voyage
à travers le Royaume lombard. Pépin répondit favorablement
et dépêcha deux ambassadeurs auprès du Pape. A leur arrivée
à Rome, ils trouvèrent Etienne II prêt à partir,
après avoir obtenu un sauf-conduit pour se rendre en la capitale des
Lombards, Pavie. La caravane quitta Rome le 14 Octobre 753. Outre les ambassadeurs
et leurs escortes, la suite pontificale se composait de nombreux clercs de haut
rang, de militaires, membres de l'aristocratie romaine; elle comprenait aussi
un ambassadeur de l'Empereur grec, porteur de lettres de ce dernier à
l'adresse de Astolf, lui demandant de restituer Ravenne et les territoires de
l'ancien Exarchat. La réponse fut totalement négative malgré
les interventions d'Etienne II en appui de la demande byzantine.
La question de Ravenne ainsi écartée,
le Pape demanda qu'on le laissa aller en Gaule. Les ambassadeurs francs parlèrent
assez fort pour que tombent les obstacles. On quitta Pavie le 15 Novembre 753.
L'ambassadeur grec et les militaires romains revinrent dans la Ville. Etienne
II continua, escorté de ses clercs et des envoyés de Pépin
le Bref. Il atteignit Aoste, puis traversa le Grand Saint Bernard, et s'arrêta
à l'abbaye de Saint-Maurice, où deux autres personnages de qualité
l'attendaient. Finalement, il fut reçu à Ponthion, aux alentours
de Vitry-le-François, la résidence royale, à l'Epiphanie
754.
Le Pape séjourna en Gaule durant environ
quatre mois. A peine arrivé, Etienne II eut un premier entretien avec
Pépin, dans son oratoire; les larmes aux yeux, il supplia le Roi de délivrer
Rome des menaces lombardes. Il y eut aussi de véritables scènes
collectives, où l'ensemble des clercs de l'Ambassade romaine et le Pape
se présentèrent devant la Cour ,"vêtus de cilices et
couverts de cendres se prosternèrent à terre, invoquant la miséricorde
de Dieu, attestant les bienheureux apôtres Pierre et Paul, et refusant
de se lever tant que Pépin, ses fils, et les nobles Francs ne leur eussent
tendu la main en signe de concours et comme une promesse de délivrance"
(7).
Pépin ne pouvait renvoyer le Pape à
Rome avant de voir quelle tournure définitive les événements
allaient prendre; compte tenu aussi de l'âge du visiteur et du temps hivernal.
Il le conduisit à l'abbaye royale de Saint-Denis où Etienne II,
fatigué, s'alita, tomba dit-on gravement malade, faillit mourir, puis
se releva miraculeusement guéri par l'intervention de Saint Denis, patron
très efficace de l'Institution. Est-ce crédible? La question importe
peu, mais la prétendue guérison miraculeuse renforçait
considérablement le prestige du Pontife, et rendait plus impérative
sa pétition.
C'est aussi vraisemblablement dans cette période que fut distribué
en Gaule le document connu sous l'appellation de "Donation de Constantin"
(8). Ce document rattaché au nom
de l'Empereur Constantin et adressé à l'Evêque de Rome Sylvestre
1er., sous le quatrième consulat de Constantin en 315, aurait pour origine
la guérison , par Sylvestre, de la lèpre dont Constantin était
affligé.
On y distingue deux parties; la première, dite Confessio par la critique,
établit les croyances que Sylvestre aurait inculquées à
Constantin; la seconde, la Donatio à proprement parler, détaille
pèle-mèle tout ce que lèguerait à Sylvestre et à
ses successeurs l'Empereur d'Occident, particulièrement la ville de Rome,
l'Italie et toutes les régions occidentales de l'Empire. Constantin aurait
déclaré, dans le texte, devoir se retirer dans la partie orientale
de l'Empire pour ne pas empiéter sur la souveraineté de l'Evêque
de Rome.
A l'évidence, il s'agit d'un faux compte
tenu des nombreux anachronismes contenus dans la " Donatio" , notamment
le legs d'églises à Rome, qui n'existaient pas en 315 -317, date
supposée de sa rédaction. D'autre part, la "Donatio"
établissait une primauté absolue de Rome sur les églises
d'Orient, principalement celle de Constantinople qui n'existait pas encore;
l'on imagine aisément ce qu'un Léon 1er. en son temps (440 -461),
aurait pu tirer d'un texte de cette importance forcément connu s'il avait
existé! En outre, la création de la ville de Constantinople s'est
imposée à Constantin comme une donnée politique et stratégique,
du fait de la présence aux frontières orientales de l'Empire,
redoutable et permanente, des Perses. Dioclétien lui avait montré
l'exemple en s'établissant à Nicomédie à la fin
du IIIème siècle.
Ce document constitue "le faux le plus célèbre
de l'histoire de la Papauté"(9)
, ou suivant A.Grafton : "le faux médiéval le plus littéraire
et le plus complexe", ou encore selon J.Carcopino : "un faux éhonté
de fabrication romaine" (10).
Là, git bien la question. On le conçoit sans peine, la "fausse
Donation" a été commandée (11)
par celui ou ceux qui en attendaient des suites favorables en la produisant
au moment opportun. Il n'est toutefois pas assuré qu'elle ait été
fabriquée à Rome. Les spécialistes pensent généralement
qu'elle a été écrite au milieu du Vlllème siècle,
c'est-à-dire dans les années 75O, et diffusée d'abord en
Gaule, où elle aurait été rédigée vraisemblablement,
compte tenu des moyens faiblement développés de transmission à
l'époque. Mais, il convient de le rappeler, ce faux ne constitue pas
un cas unique; il s'inscrit dans une tradition illustrée par de célèbres
fausses "Donations", telle la "Donation de Dagobert" produite
à Saint-Denis. La richesse accumulée par les grandes institutions
monastiques aiguisait la convoitise et appétits d'évêques,
et autres seigneurs féodaux. Les moines se servirent pour leur défense
de l'arme en leur possession presque exclusive: la culture; les scriptoria conventuels
représentaient, à l'époque, les seuls conservatoires de
la lecture et de l'écriture; cette dernière gardait un caractère
"sacré" tel, que ce qui était écrit exprimait
la vérité, ce qu'il fallait croire. En outre, l'introduction de
la minuscule caroline révolutionnait l'art d'écrire et rendait
progressivement illisibles les documents authentiques mérovingiens.Il
existait donc dans les scriptoria des grands établissements monastiques
un certain nombre de manuscrits inutilisés, anciens ou très anciens,
qui permirent à quelques rares spécialistes antiquisants, à
partir de ces parchemins, après les avoir lavés, de fabriquer
littéralement une histoire utile à la défense de leurs
intérêts.Le volume de ces contrefaçons ne fut jamais négligeable.
A.Grafton précise:
"parmi
les actes que nous possèdons, on peut sans doute considérer comme
frauduleux la moitié de ceux qui datent de l'époque mérovingienne,
et les deux tiers de tous ceux qui ont été dressés
avant 1100 par des clercs. Leur nombre s'accrut considérablement lorsque
la science juridique se fut solidement implantée en Occident, et
qu'il fallut des pièces justificatives pour établir tous les usages
et tous les droits de propriété " (12).
Patrick Geary a démontré lumineusement les mécanismes de
cette fabrication du passé, ayant pour seul but l'utilité et la
défense des droits acquis (13).
Carlo Ginzburg stigmatise, lui, cette culture d'antiquaires, de vulgarisateurs,
de fabricants de copies et de faussaires (14).
Bref, c'est une hypothèse bien vraisemblable,
la "Donation de Constantin" aurait été rédigée
par un ou plusieurs moines de Saint-Denis et copiée dans le scriptorium
en quelques exemplaires distribués à la Cour franque; ils auraient
eu trois mois environ pour exécuter ce travail, à la demande de
l'entourage pontifical durant le séjour d'Etienne II à l'abbaye
royale; c'était une contribution à la cause de Saint Pierre parachevant
la guérison miraculeuse du Pape. Ne dit-on pas que l'Abbé de Saint-Denis: "s'était
signalé par le plus grand zèle pour le Saint-Siège"
(15).
Mais l'Histoire poursuit son cours. Deux Assemblées
nationales franques se tinrent le 1er. Mars 754 et le 14 Avril à Braisne
et à Quierzy-sur-Oise. La guerre fut décidée, non sans
opposition, contre le roi des Lombards pour l'obliger à satisfaire aux
demandes d'Etienne II. L'armée franque traversa les Alpes par la Maurienne
et le col du Mont-Cenis. Pépin investit Pavie la capitale d'Astolf; celui-ci
dut finalement cèder et traiter sur la base des revendications romaines,y
compris la rétrocession, au Pape, de Ravenne et des territoires formant
l'ancien Exarchat; la "Donation de Constantin" avait en effet établi
très clairement que ces terres italiennes étaient comprises dans
l'héritage du Pontife bien avant l'installation des Grecs; il fallait
respecter la volonté du grand Empereur défunt, qui pour tout le
monde avait fondé le Christianisme romain.
Pépin fit raccompagner Etienne II à
Rome par des aristocrates de son entourage, à la fin du mois de Novembre
754. Ce dernier fut accueilli triomphalement par la population de sa Ville;
après l'absence d'une année, il revenait en souverain, héritier
de Constantin, son grand Patron. Son bonheur fut de courte durée. Certes,
Astolf commença par rendre quelques unes des possessions inscrites au
traité de paix signé. Toutefois, dès que les Francs, après
s'être retirés, furent assez éloignés pour ne plus
constituer de menace, il reprit, dans le courant de l'année 755, ses
incursions dans les Etats pontificaux et ses pillages dans la Campagne romaine.
Il vint presque sous les murs de la Ville et vola les reliques de Saint Sylvestre
dont il fit cadeau à un ancien duc lombard, Anselme, devenu moine, et
dont il avait épousé la fille. Les restes de Saint Sylvestre furent
amenés au monastère de Nonantula; plus tard les moines essayèrent
de régulariser l'affaire en fabriquant des lettres de cession.
Etienne ne put que s'en plaindre par lettres adressées
à Pépin, qui se renseigna. Astolf préparait une invasion
de Rome, et, le 1er. Janvier 756, attaqua la Ville en trois points. Le Pape
réussit à faire sortir des messagers qui prirent la mer pour se
rendre en Gaule; ils étaient porteurs de trois lettres:la première
était rédigée par Etienne en son nom personnel, la seconde
exprimait les peurs du peuple romain tout entier et ses appels au secours, la
dernière venait de l'Apôtre Pierre lui~même qui en tant que
porteur des clés du Ciel s'adressait directement à Pépin;
il était, disait-il, menacé directement dans son sanctuaire; lui
venir en aide, assurerait à son sauveur des droits spéciaux à
sa reconnaissance. En d'autres termes, Pierre promettait le Ciel à Pépin
s'il venait au secours de Rome (16) !
Pépin se remit immédiatement en
campagne et traversa les Alpes au Mont-Cenis; Rome fut alors entièrement
dégagée. Les Francs investirent à nouveau Pavie, battirent
Astolf, le condamnèrent à cèder des villes non comprises
dans le traité précédent, et à verser une forte
contribution de guerre; de surcroît, le tribut versé jadis par
les Lombards aux Rois francs fut rétabli. Pour assurer l'exécution
de ce nouvel accord, l'Abbé Fuald, un proche de Pépin, demeura
en Italie avec un corps d'armée suffisant; il visita chaque cité
stipulée dans les actes, accompagné de Commissaires lombards;
il s'en fit remettre les clés, qu'il vint déposer à Saint-Pierre
de Rome, avec une attestation par laquelle Pépin en faisait don à
l'Apôtre Pierre et à tous ses successeurs. Le Roi des Francs reçu,
en contrepartie, le titre de Patrice des Romains, sans savoir exactement quelle
signification lui donner.
La pièce était jouée. Cependant,
des questions demeurent et sur la crédulité de Pépin et
sur le manque de savoir-faire de l'Apôtre Pierre. Pépin était-il
assez naïf pour penser recevoir une lettre personnelle de Saint Pierre,
Portier du Ciel? S'était-il mis en campagne uniquement pour l'amour de
l'Apôtre, la rémission de ses péchés, et assurer
son entrée au Paradis? On peut estimer, plus justement, que la trahison
d'Astolf constituait une grave offense et une véritable provocation,
qu'il devait payer fort cher. Les pieuses protestations de Pépin sont
toutefois caractéristiques du climat général de superstition
et de faim de magie qui règnait en Europe Occidentale; alimenté
par l'Eglise romaine, il conditionnait les esprits des plus hauts aristocrates.
Pépin agissait comme Oswy, Roi de Northumbrie; selon Bède le Vénérable,
ce Roi aurait déclaré, à propos de la fixation de la date
de Pâques, et de Pierre: "Voilà un portier
auquel je refuse de m'opposer Je désire obéir en tout à
ses prescriptions; j'ai trop peur qu'à mon arrivée aux portes
du Ciel il n'y ait personne pour m'ouvrir" (17).
L'on peut s'étonner alors du manque de
savoir-faire. d'un tel personnage "divin" ! Pierre aurait pu envoyer
directement sa lettre à Pépin par les airs;l'effet eut été
plus saisissant et la réaction de secours plus rapide. Passer par l'intermédiaire
d'Etienne faisait perdre au moins deux mois, et faisait peser sur son sanctuaire
la menace furieuse d'un saccage par les Lombards. Serait-ce la preuve que la
Providence écrit droit avec des lignes brisées? Mais nous quittons
le domaine de l'histoire pour celui de l'hagiographie.
Le rideau du théâtre lombard tomba
à l'automne 756 avec la mort d'Astolf, tué dans un accident de
chasse. Sa succession opposa deux compétiteurs : Ratchis,son frère,
qui avait antérieurement,en 749, abandonné le trône pour
la vie monastique au Mont Cassin; et Didier, duc de Toscane. Ce dernier
se mit en rapport avec le Pape pour obtenir son soutien, contre la promesse
de cession de plusieurs cités importantes, promesse dûment signée
en présence des représentants du Pontife, dont l'Abbé Fuald.
C'était un complet retournement de situation. Il n'était pas très
difficile pour l'Administration pontificale de persuader Ratchis de retourner
au Mont-Cassin; Didier fut donc proclamé roi des Lombards, mais se montra
finalement peu enclin à exécuter rapidement ses promesses.
Etienne II s'était montré comme
un Souverain apprécié, suffisamment puissant pour arbitrer les
candidatures à la royauté lombarde. Il exultait et exprima sa
joie en une lettre à Pépin. C'est sur ces entrefaites qu'il mourut
le 26 Avril 757.
Une courte période de cinq ans fut suffisante
pour dénouer une situation multiséculaire. L'accession du Pape
de Rome à la royauté élective manifestait simultanément
le déclin de l'Empire romain d'Orient et l'avènement de puissances
impériales en Europe Occidentale, d'abord les Carolingiens, puis les
Ottoniens. Rome se voyait à nouveau "Caput Mundi", et ses rêves,
pour se concrétiser, avaient fabriqué le subterfuge de la "Donation
de Constantin". Ce faux avéré fut dénoncé à
maintes reprises après sa parution, et particulièrement en 1440
par un humaniste italien, Lorenzo Valla. L'Etat pontifical réagit en
fonction de ses intérêts; il inscrivit cette fausse "Donation"
dans les collections canoniques, en la transformant en acte juridique de restitution,
"un privilège fondateur de droit" (18).
C'était un moyen royal de protèger ses biens par l'écriture,
un parachèvement de la "Donation". L'on prône la pauvreté
comme moyen de sanctification, mais l'on s'ingénie à protèger
et accroître ses possessions terrestres, tant l'attirance de l'or, chair
du Soleil, pousse au double langage et à des attitudes extrêmes.
La fausseté du document fut officiellement
admise en plein XIXème siècle par l'Etat-Eglise pontifical, au
moment où ce dernier était totalement dépouillé
par l'effet du Risorgimento et de l'unification italienne. La réalisation
par la Maison de Savoie du très vieux rêve du roi lombard Liutprand
avait ôté toute utilité à la "Donation".
.
Constantin, malgré l'adoration de son vivant
par les populations de son Empire, malgré ses titres de Pontifex Maximus
et de Christos, Contantin était hypostasié en une idole, dont
la puissance supposée naissait des rosaires de superstitions égrenées
par l'Eglise romaine. L'attrait du Pouvoir dit temporel, de la possession de
territoires très importants, de la richesse sous toutes ses formes, muait
ses fonctionnaires en agents d'une volonté de puissance collective par
laquelle le Pontife romain se montra non plus le Vicaire d'un dieu-esclave,
mais l'heureux héritier des Empereurs du passé.
Cette
composition veut illustrer l'origine mensongère de la fausse "
Donation de Constantin ".
L'Empereur est représenté dans la situation
d'un humble serviteur de l'Evêque de Rome; Constantin, à pieds,
conduit par une rêne le cheval qui porte Sylvestre I er. Or, du temps
de Constantin, tous les Evêques, y compris ceux de Rome, étaient
des fonctionnaires salariés, chargés de développer
dans les basiliques, collégiales ou autres édifices, le culte
impérial, le culte de l'Unique Maître de l'immense Empire romain,
toujours en quête d'unité, le Christ, représentant unique
du Dieu unique défini par le Concile de Nicée en 325.
On a ici un exemple typique des manipulations opérées
sans cesse par l'Eglise de Rome, en particulier, pour affirmer sur Terre
sa primauté sur toutes les Autorités. Depuis Grégoire
Ier, elle utilisait sciemment les images peintes ou sculptées comme
moyens d'instruire les foules des illettrés, dont l'imagination et
l'inconscient étaient totalement subjugués par la puissance
de suggestion des icônes et statues.
On comprend ainsi que l'Eglise de Rome ait été,
dès 726, hostile à l'iconoclasme bysantin; elle aurait été
privée de son principal instrument de propagande, au service de sa
volonté passionnelle de représenter ici-bas, sans contestation,
l'autorité qui vient du Dieu " Empereur celeste ", hypostase
constantinienne.
|

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) - Cf.. Richard KRAUTHEIMER -"Rome portrait d'une ville" Editeur
le Livre de Poche - Paris Voir page 110. RETOUR
.(2) - Cf. JORDANES - "Histoire des Goths" - Editeur Les Belles Lettres
Paris. RETOUR
(3) - Cf. Richard KRAUTHEIMER - Op.cit. Pages 171 et 172 RETOUR
(4) - Cf. Richard KRAUTHEIMER - Op.cit. Page 201 RETOUR
(5) - Cf. Mgr: DUCHESNE -"L'Eglise au VIème siècle"
Editeur de Boccard - Paris pages 127 et 128. RETOUR
(6) - Cf. Jérôme CARCOPINO -"Etudes d'Histoire chrétienne
-Les fouilles de Saint-Pierre" Editeur Albin Michel -Paris Pages 132 -133.
RETOUR
(7) -Cf. Mgr. DUCHESNE -"Les premiers temps de l'Etat Pontifical"Editeur
Fontemoing et Cie -ParisPage 59 RETOUR
(8) -Cf. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA PAPAUTE -Op.cit.Article "Donation
de Constantin" Pages 581 et suivantes RETOUR
(9) -Cf. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA PAPAUTE -Op.cit. RETOUR
(10) -Cf. A.GRAFTON -"Faussaires et critiques" -Editeur Les Belles
lettres -Paris. Page 33. RETOUR
(11) -Cf. J.CARCOPINO -"Etudes d'Histoire chrétienne" -Op.cit.
-Page 211 RETOUR
(12) -Cf. A.GRAFTON -"Faussaires et critiques" -Op.cit. -Page 33 RETOUR
(13) -Cf. Patrik J.Geary -"La mémoire et l'oubli à la fin
du premier millénaire"Editeur Aubier -Paris. RETOUR
(14) -Cf. CARLO GINZBURG -"La Donation de Constantin" -Préface.
Editeur Les Belles Lettres -Paris RETOUR
(15) -Cf. Mgr. DUCHESNE -"Les premiers temps de l'Etat Pontifical"
-Op.cit Page 83. RETOUR
(16) -Cf.Mgr. DUCHESNE -"Les premiers temps de l'Etat Pontifical"
-Op.cit Page 72. RETOUR
(17) -Cf.BEDE LE VENERABLE -"Histoire ecclésiastique du peuple anglais"
Editeur Les
Belles Lettres -Paris. Livre III -Chapitre XXV -Page 188 RETOUR
(18) -Cf. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA PAPAUTE -Op.cit. -Page 582. RETOUR
LES
PREMIERS TEMPS DE L'ETAT PONTIFICAL ( SUITE)