CONCLUSION
LE
TRIPTYQUE DE STAVELOT EN BELGIQUE (XIIème siècle)
Ce
magnifique ouvrage est un reliquaire de la "vraie" croix:
Le volet
central comporte deux crucifixions
.Celle du haut, la plus petite, est
une splendide illustration du thème du dieu fécondateur triomphant; le
crucifié est vivant, les bras non fléchis, la tête droite, d'abondants
filets de sang stylisés coulent de ses deux mains en pluie fécondatrice
sur la terre; au-dessus de la croix, le soleil et la lune, principes de la
fécondité, attestent cette signification.
La croix au centre du volet
constitue le véritable réceptacle du morceau de bois vendu comme relique
de la "vraie" croix par des moines avides et sans scrupule.
A supposer
la véracité "historique" des récits évangéliques, aucun d'entre eux n'a
jamais signalé le dépôt de la croix du supplice dans le
tombeau du
Sauveur, ni la présence d'une croix dans celui-ci à la Résurrection. Une
croix latine n'aurait pu, d'ailleurs, y entrer compte tenu des dimensions
respectives du sépulcre et de cet arbre du malheur (arbor infelix). En
outre, la croix du supplice appartenait à l'armée romaine, qui la
maintenait en vue du public sur la colline, pour servir d'avertissement et
créer la crainte d'avoir à y être suspendu jusqu'au dernier
souffle. |
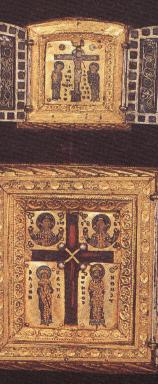 |
Le volet de gauche, pour un
fidèle en prière, représente trois épisodes de la vie de Constantin, rapportée
par l'hagiographie dite "Vie de Constantin", attribuée à Eusèbe de Césarée.
La partie haute décrit le baptême supposé de l'Empereur,
alors que l'on ne sait si, à sa mort en 337, il avait reçu ce sacrement;
vraisemblablement non; sa "divinite" rendait inutile son
immersion. |
 |
|
Le volet de droite,
le plus intéressant, illustre l'invention de la "vraie" croix, découverte,
dit-on, par l'Impératrice Hélène, mère de Constantin. Celle-ci, à vrai
dire, était à l'époque beaucoup trop âgée, si encore en vie, pour
supporter un long voyage terrestre très fatigant de Constantinople à
Jérusalem et retour.
Le panneau, en bas, résume, en fait, le récit de
"l'invention", tiré de la légende du roi Abgar d'Edesse en Syrie. Ce récit
attribue " l'invention" à Protonice, épouse supposée de l'Empereur Claude
(41 -54). La scène raconte la discussion de Protonice avec les chefs des
Juifs pour obtenir d'eux des renseignements sur l'emplacement du sépulcre
du Sauveur, sous la menace des flammes d'un bûcher. Mais comment les
disciples de Jésus Christ, quinze ans environ après son supposé supplice,
auraient-ils pu oublier le lieu de sa sépulture et de sa résurrection? La
présence d'un bûcher en flammes est en outre caractéristique d'une
mentalité moyenâgeuse selon laquelle, les Juifs, déicides présumés,
auraient toujours été soumis à des tortures diverses; ce qui est faux.
L'anti-judaïsme chrétien est né à la fin du XIème siècle à l'occasion
de la première croisade, parce que les Juifs étaient devenus si puissants,
financièrement parlant, qu'il fallait bien les détruire.
Les deuxième
et troisième panneaux illustrent, d'une part la découverte du sépulcre et
de trois croix à l'intérieur, et d'autre part la résurrection de la fille
de Protonice, morte subitement à l'entrée du sépulcre, et ramenée à la vie
par l'imposition sur sa poitrine d'une croix qui se révèla, par ses vertus
vivifiantes, la croix du Sauveur.
Les trois croix sont, en fait, non pas trois croix de supplice que des
femmes n'auraient pu déplacer, mais trois amulettes en forme de croix,
telles que l'on en exportait partout, notamment d'Egypte.
L'invention de la "vraie" croix (une amulette) apparaît comme un récit
de faussaires qui abusèrent cyniquement de la crédulité des pélerins à
Jérusalem, pour bâtir et orner somptueusement leurs établissements en
cette ville.
Jérusalem, capitale virtuelle de la chrétienté, devint une mine d'or,
mais la richesse manifestait bien la divinité de Jésus- Christ puisqu'il
était le dieu de la fécondité
|
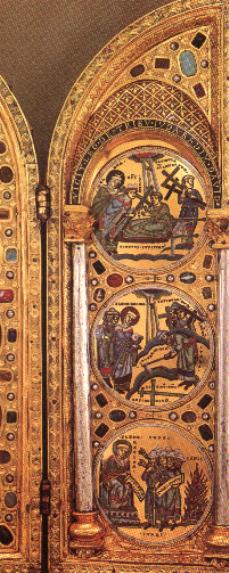 |
I L'EGLISE,
ADMINISTRATION RELIGIEUSE DE L'EMPIRE ( 325 - 750 )
SOMMAIRE
1 La
religion chrétienne au IVème siècle
2 Constantin,
l'homme divin de l'Empire
3 Constantin,
Chef de l'Eglise catholique
4 L'Eglise
romaine. après la dynastie constantinienne (364 -754)
1 La religion chrétienne au IVème siècle
Après le Grand Schisme d'Occident, et le Concile
de Bâle, en 1414 -1418, Enea Piccolomini émit une théorie sur le Pouvoir Pontifical,
unissant dans la personne du Pape autorité spirituelle et autorité temporelle,
afin d'éviter les conflits entre ces deux sphères (1). Il disait en effet: "le Pontife romain sans le patrimoine de l'Eglise
n'est rien d'autre que l'esclave des princes et des rois". Ce patrimoine était
présenté comme le garant de l'indépendance pontificale.
Toutefois, la théorie de Piccolomini, comme
toutes les théories, s'avérait juste dans des circonstances déterminées mais
totalement fausse dans un contexte différent. De fait, le patrimoine de l'Eglise,
barrant l'Italie Centrale de la Méditerranée à l'Adriatique, où il se rapprochait
de Venise, attisait les convoitises des roitelets, princes, ou nobles de moindre
extraction; sa défense obligeait le Pape à se muer parfois en chef de guerre,
et toujours en diplomate affairé, le conduisant à délaisser les problèmes
concernant son "autorité spirituelle". D'indépendance, point ! Sinon au prix
de marchandages incessants, transformant le Pape en souverain ordinaire. Piccolomini
lui-même, élu Pie II en Avril 1458, pour assurer la sauvegarde de ses possessions
terrestres, mésusa du népotisme; il mourut à Ancône, six ans plus tard, attendant
des navires et des troupes qui ne vinrent pas, pour aller combattre les Turcs.
Quelle "autorité spirituelle"
pouvait prétendre manifester l'évêque de Rome? La question nous oblige à
redéfinir la religion chrétienne avant sa transformation en
christianisme.
La religion chrétienne est
essentiellement le culte d'un Sauveur invisible agissant pour le bien de ses
fidèles, malgré les apparences contraires de leur vie terrestre; Sauveur dont le
triomphe sur leurs ennemis, à la fin des temps, assurera à chacun de ses fidèles
un bonheur parfait et éternel. Mais on ne naît pas chrétien disait Tertullien;
on le devenait par la grâce de l'eau et de l'huile du baptême, reçu à la fin
d'une initiation doctrinale, qui ouvrait à un impétrant les portes d'une
communauté. De communauté à communauté, les pratiques rituelles et la doctrine
enseignée pouvaient différer; chacune toutefois regroupait majoritairement une
population de prolétaires et d'esclaves exprimant par leur adhésion une
opposition irréductible à la Société
romaine.
Le culte chrétien mettait en oeuvre
une très forte espérance eschatologique aux racines psycho-sociologiques
profondes, nourrissant une certitude de victoire définitive sur les
propriétaires romains, certitude d'autant plus forte que cette vision des temps
futurs de parfait bonheur, ces lendemains enchanteurs rêvés, compensait une
situation concrête plus misérable,
désespérante.
Ce Sauveur campait donc un
guerrier victorieux, idéalisant l'image de Spartacus adoré de son vivant comme
un impérator divin, et enlevé du champ de sa dernière bataille dans un char
conduit par sa compagne, la prophétesse de Sabazius, divinité thrace confondue
avec Dionysos. L'attente de son retour triomphal était sans cesse vivifiée par
les manifestations orales, hallucinées, des apôtres itinérants, visitant,à la
suite de Chrestus, groupe après groupe, pour propager l'espérance chrétienne
d'une nouvelle vie, permettant de supporter les infamies de l'existence
présente. Bien vite, on se persuada que pour vaincre les Romains oppresseurs, le
Sauveur chrétien devait dominer leurs dieux; progressivement, de thérapeute il
devint finalement le dieu chrétien de la Fécondité. Il connaissait d'autant
mieux les besoins de ses fidèles, qu'autrefois, dans un passé indéterminé, il
s'était fait esclave, souffrant comme un esclave d'une situation totalement
inhumaine, dont il garantissait la fin, la transformation en un triomphe
définitif sur les propriétaires romains.
La
traduction, la lecture et les commentaires de la Septante par les
fonctionnaires-esclaves "lettrés" permirent aux
communautés:
- d'une
part, d'inclure dans leur système de pensée une cosmogonie, issue de la Genèse;
la création consistait selon eux à faire naître quelque chose ou quelqu'un du
néant. Ces "lettrés" ne savaient pas que de rien, rien ne vient; ils n'avaient
pas lu les Satires de Perse, mort dans la première partie du premier siècle de
notre ère.
- d'autre part, de découvrir
dans la Septante la description d'événements intervenant comme des promesses
des actes de leur Sauveur.
Ces lectures et commentaires variaient avec
chaque lecteur, d'où l'éclosion rapide, dans la deuxième partie du deuxième
siècle de notre ère, d'un sectarisme ravageur, terreau d'une orthodoxie redoutable,
qui devint la loi du nombre et non de la raison, mais aussi une cause constante
de troubles de l'ordre public. Après les marcionites, les montanistes, les
gnostiques égyptiens et autres hérétiques, ces antagonismes intercommunautaires
dressèrent au IIIème siècle, Etienne, évêque de Rome, contre Cyprien, Pape
de Carthage, Firminien de Cappadoce, et d'autres évêques espagnols. A Carthage
même, les "purs", les fidèles de Donat, excommuniaient les membres des autres
communautés de la ville; en 313, ils contestèrent violemment l'élection de
Cécilien au siège épiscopal. La confusion grandissait à la fin de ce IIIème
siècle qui avait vu croître, dans les villes, le nombre des collegia admis
à pratiquer leur culte privé, sous le regard d'une administration impériale
dont l'évêque-surveillant de chaque association était l'intermédiaire.
Qu'était donc la
sociologie chrétienne au tournant des IIIème et IVème siècle? Un conglomérat
d'associations n'ayant en commun que le nom, des rites et des livres.
Fréquemment opposées entre elles sur des points de "doctrine", elles
signifiaient par là que leur concept d'un dieu, trinitaire, n'avait pas une
origine divine mais simplement humaine. Ce dieu conceptualisé reflètait les
divergences des lectures de la
Septante.
Le pire vint avec la dispute
arienne relative à la nature du Fils de Dieu, assimilé au Logos, et qu'un prêtre
d'Alexandrie nommé Arius (environ 260 -337) désignait comme une créature tirée
du néant. Cette dispute, alimentée par le caractère intransigeant des
adversaires, notamment Arius, Alexandre, évêque d'Alexandrie, Athanase son
successeur, sinon leur entêtement, provoqua en Orient, au-delà d'Alexandrie, de
véritables troubles; ceux-ci provoquèrent inévitablement les réponses
appropriées des Autorités impériales.
La
querelle couvait depuis la fin du IIIème siècle, ce fut vraisemblablement une
des raisons qui poussèrent Dioclétien, siègeant à Nicomédie, à décréter la
destruction des livres "sacrés" des Chrétiens, puisque ceux-ci trouvaient en
ceux-là les occasions de s'entre-déchirer en violant fréquemment cet ordre
public, dont le maintien constituait une des préoccupations majeures de
l'Empereur.
La persécution-censure de Dioclétien dura, en
Orient, par vagues successives, de 303 à 324. Elle marqua si fortement les
esprits qu'en 525, du temps de Denys le Petit, on parlait encore à Alexandrie
de l'ère historique de Dioclétien comme de "l'ère des martyrs". Nul doute
qu'en Orient et Occident les mesures décrétées par Dioclétien entraînèrent
la destruction totale des bibliothèques chrétiennes, au moins dans les agglomérations
importantes. On cite le cas contraire, pratiquement unique, d'Abthugni, modeste
bourgade au Sud Ouest de Carthage, où une complicité de fait entre Chrétiens
et Autorités locales évita aux premiers d'avoir à trahir leur foi (2). A contrario, la destruction de la bibliothèque de l'Eglise de Rome,
répartie sans doute en plusieurs locaux, est attestée par un ouvrage "Aux
origines du christianisme" (3).
Rien n'est plus marquant à cet
égard qu'une étude, publiée en 1985, sur les plus anciens manuscrits de la Bible
latine (4). L'auteur nous rappelle qu'à Cirta, l'actuelle Constantine, la
perquisition opérée le 19 Mai 303 a permis de saisir 34 livres; il ajoute, en
terme de comparaison, qu'en 471 l'église de Tivoli, localité pratiquement
équivalente à Cirta, possèdait seulement 4 évangiles, un livre des " Actes
d'Apôtres" et un Psautier. Globalement, 1'auteur décompte 93 manuscrits sur
parchemin qui constituent les plus anciens manuscrits de la Bible latine; aucun
n'est antérieur à la persécution de Dioclétien. Pratiquement, tous datent du
Vème ou VIème siècle; 3 chevauchent la fin du IVème et le début du Vème siècle;
un seul appartient au IVème siècle. La première Bible complète, dont nous
n'avons que des fragments, est espagnole et du VIIème siècle. Le premier Nouveau
Testament complet est constitué par le Codex Fuldensis, de 546
-547.
La Septante a certainement été retraduite
à partir de 313 au plus tard; il faut imaginer que tous les manuscrits ont été
tracés sur du papyrus, fragile, comme support. Les généreuses subventions de
Constantin aux diverses communautés reconstituées ont été utilisées à d'autres
fins qu'à des achats de parchemin. Avait-on si peu de considération pour les
textes "divins"?
En tout état de cause,
Victor, évêque de Capoue, à qui nous devons le premier Nouveau Testament
complet, daté de 546 547, apparaît dans ce travail comme un correcteur,
correcteur d'orthographe, mais surtout correcteur du texte des épitres
pauliniennes par l'utilisation d'un manuscrit qui lui paraissait être un
original. Il nous introduit dans le monde "des hommes du livre" : scribes,
réviseurs, lecteurs, libraires... , de la fin de l'Antiquité Tardive et des
débuts du Haut Moyen-Age. Le sens des écritures "sacrées" semblait souvent
obscur aux plus instruits; la nécessité d'explications en face du texte laissait
pressentir l'irruption de la glossa ordinaria, à la fin du XIIème siècle. Déjà,
une partie de ces explications passait dans le texte du temps même de Jérôme
(347- 420). Chaque copiste s'évertuait, certes, à la vigilance, mais que
pouvait-il contre la pénibilité et la lenteur de l'acte d'écrire? (il fallait
introduire l'encre dans le parchemin; on écrivait avec 3 doigts mais tout le
corps travaillait ); que pouvait-il contre la fatigue, la somnolence, le
désintéret, le froid du scriptorium, l'engourdissement de ses doigts, ou leurs
déformations qui empêchaient l'exécution correcte des
lettres?.
Par ailleurs, chaque lecteur
devenait, à voix haute, malgré lui, un réviseur; il lisait ce qu'il croyait
voir, puisque chaque perception est une interprétation. Déjà, donc, un texte
"sacré" ou non, variait pratiquement à chaque copie. Jérôme accusait Rufin
d'Aquilée de fausser les écrits d'Eusèbe de Césarée, ses réflexions ne faisant
qu'anticiper, à sa manière, les travaux de nos contemporains sur la variabilité
continuelle d'un texte avant l'invention de
l'imprimerie.
La persécution de Dioclétien avait ,certes,
d'autres raisons que les troubles de l'ordre public causés par des querelles
chrétiennes. La plus importante se fondait sur l'opposition absolue des communautés
chrétiennes au culte de l'Empereur qui cimentait l'unité de l'Empire. On craignait
aussi une contagion chrétienne dans l'armée, car deux soldats s'étaient rebellés
au nom de leur foi et avaient subi le châtiment extrême réservé à ces cas
d'indiscipline majeure. Aussi bien, la destruction fut particulièrement étendue
à tous les biens communautaires; outre les livres "divins", les objets du
culte, les autels, les immeubles, voire les stocks des biens à répartir entre
les plus pauvres furent saisis, abattus, brûlés. Par contre, il y eut peu
de martyrs véritables; comme lors des persécutions précédentes, les foules
abjurèrent les croyances chrétiennes et sacrifièrent devant les effigies de
l'Empereur; l'impératif était de vivre. Dans ce contexte généralisé de menaces
mortelles et de destructions massives, la bienveillance relative de Constantin
fit de ce dernier le Sauveur espéré des Chrétiens.
2 Constantin, l'homme
divin de l'Empire
Constantin prit en 307 le
titre de Pontifex Maximus, charge exercée par Jules César et chaque Empereur
après ce dernier. Les Pontifes constituaient le collège de prêtres le plus
important (5); leur groupement compta jusqu'à seize membres sous Jules César. Ils
incarnaient la tradition religieuse et organisaient le culte public; ils
fixaient les jours fastes et néfastes, ainsi que le calendrier des fêtes; ils
gardaient aussi les archives des principaux événements de l'année. Le nom de
pontifes donné à ces prêtres tenait, selon Varron le plus instruit des Romains
d'après Cicéron, au travail de reconstruction en bois du pont Sublicius, le seul
pont de Rome pendant plusieurs siècles, travail ponctué de rites religieux. Le
Chef du collège, ou Pontifex Maximus, contrôlait l'ensemble de la religion
publique et prenait le pas, en ce domaine, sur le "Rex
Sacrorum".
Comme le pont Sublicius fut
emporté par une violente crue du Tibre en l'an 69 de notre ère, le maintien de
l'appellation dans la titulature impériale engendra une allégorisation, conforme
à la théologie royale décrite dans 1" "Hermes Trismégiste" à la fin du IIème
siècle (6).
Le prince, roi ou empereur, était définitivement d'origine
divine; "dernier des dieux et premier des hommes", il s'établissait comme le
grand intermédiaire, comme le grand pont, entre la divinité et la population de
son royaume. Dans l'Empire romain, nul ne pouvait douter de la sacralité de
l'Empereur, célébré comme un dieu, divus, après sa mort par le
Sénat.
Constantin pour sa part condensait
à son époque, par son titre de Pontifex Maximus, toute la sacralité de la
religion publique romaine, manifestant ainsi son origine céleste. La preuve
certaine en résidait dans les visions "divines" annonciatrices de victoires,
qu'il avait reçues au moins en deux
occasions:
- la
première fut une vision d'Apollon en 309, qui lui valut de remporter une
importante bataille en
Gaule.
- la
deuxième, consista,selon Eusèbe de Césarée, dans la vision du chrisme qu'il
arbora sur ses étendards au pont Milvius le 28 Octobre
312.
Ce sigle permit à ses troupes de rester
groupées dans une bataille à l'issue fort douteuse, où s'affrontèrent Romains
contre Romains, habillés et armés de la même manière, les adversaires se distinguant
difficilement les uns des autres. Le chrisme, en signe de ralliement, permit
aux troupes constantiniennes de maintenir leur front, de rester soudées, et
de remporter une victoire décisive, à la suite de laquelle l'Auguste Constantin
se nomma Empereur d'Occident.
Déjà en 272, l'Empereur Aurélien (270
275) dans sa campagne contre Zénobie, reine de Palmyre, avait été gratifié
dans son sommeil d'une vision du dieu d'Emèse en Syrie, le Sol invictus, autrefois
célèbré par Héliogabal (218 -222). Il avait obtenu grâce aux renseignements
divins de battre Zénobie et de redonner à l'Empire son Unité et grandeur anciennes.
Nul, donc, ne
pouvait mettre en doute l'appui divin dont bénéficiait Constantin, cet appui
témoignant, assurément, de son origine céleste. Un seul compétiteur se déclara
son égal, en tout : Licinius. Mais il ne suffisait pas à ce dernier d'orner ses
bannières du chrisme constantinien pour gagner les batailles et prétendre ainsi
à une ascendance "sacrée". La guerre dura 10 ans entre les deux postulants au
titre suprême de seul Empereur des Romains. La loi des armes intervint comme une
ordalie, un jugement de Dieu, et fit triompher Constantin en 324, en attestant
devant tous son origine divine.
Le
chrisme proclamait non seulement cette origine, mais, bien plus, l'exclusivité
de celle-ci. Par ses monnaies, ses médailles, ses bannières, Constantin était
déclaré, en effet, 0 Christos, c'est-à-dire le seul béni de Dieu, l'unique
représentant d'une divinité qu'il devait faire déclarer unique par le Concile de
Nicée en 325.
Auparavant, celà
aurait semblé totalement impossible que des Chrétiens en viennent à vénérer en
la personne d'un Empereur le représentant unique du Dieu unique, qui
concurrençait leur Sauveur.Constantin, depuis 307, et surtout après 313, avait
pu non seulement faire cesser les persécutions dans son royaume, mais combler de
généreuses subventions les communautés chrétiennes reconstituées dans les
villes; il s'était acquis par sa générosité politique l'attachement des
fonctionnaires-esclaves "lettrés", qui exerçaient une si forte influence sur les
masses serviles et prolétariennes urbaines. En rétablissant les lieux de
réunions des Chrétiens, en dotant les basiliques et collégiales d'un riche
patrimoine, en autorisant enfin un culte public et officiel de la nouvelle
religion, Constantin était devenu son fondateur véritable, le Christ-Dieu des
Chrétiens.
Loin de contester sa divinité,
les évêques chrétiens devinrent ses sujets fidèles et empressés, soumettant
leurs querelles "doctrinales" à l'arbitrage final de l'Empereur-Dieu. Un siècle
plus tard, les esclaves chrétiens apprendront que leur état de servitude
manifestait une grâce providentielle (7).
3 Constantin, Chef de l'Eglise
catholique
A
l'évidence, aucun évêque chrétien n'osa contester la divinité de Constantin, et
lui opposer sa croyance en un autre Sauveur. Trop englués dans leurs querelles
"doctrinales", animés d'un esprit sectaire qui les dressait souvent les uns
contre les autres, prêts à tous les faux pour discréditer l'adversaire, ces
évêques recevaient avec béatitude les dons de l'Empereur, non seulement le don
de la vie par l'arrêt des persécutions, mais aussi des compensations pécuniaires
importantes aux dommages subis antérieurement, des immeubles, des terres
patrimoniales, la reconnaissance officielle de leur
culte.
Bref, ils passaient sans
transition du stade d'associations étroitement surveillées,c'est-à-dire
suspectes, agglomérées en un mouvement potentiellement dangereux pour l'ordre
public, à celui d'une Eglise unitaire sinon unique, sous la direction effective
de Constantin. Cette Eglise devint un objet de la politique de l'Empereur, qui
la regarda: "comme un élément fondamental de son projet de gouvernement" (8).
Constantin n'avait qu'un
seul but, une seule passion: le Pouvoir; c'est-à-dire l'unification de l'Empire
de plus en plus étroite par le culte de plus en plus répandu de sa personne.
Possèdant à la fois une autorité temporelle et une autorité spirituelle sans
égales, il fonda véritablement le Césaro-papisme; il statufia en lui-même le
modèle futur du Pape romain, qui ne se réclamera jamais ni de l'Ecriture
"sacrée" chrétienne, ni de la Tradition apostolique pour asseoir son Pouvoir,
mais uniquement d'un héritage, supposé, de
Constantin.
Nous n'avons pas à nous
étendre sur l'activité des évêques chrétiens habituels usagers de la poste
impériale, devenus des agents de propagande du culte constantinien. Nous
retiendrons de l'exercice du Pouvoir temporel trois faits majeurs établis par
des constructions "sacrées"
:
-A Constantinople,
nouvelle capitale de l'Empire, d'une part l'édification, au centre- ville, d'une
statue monumentale sur un pylône de pierres rouges représentant Constantin
en divinité solaire illuminant de ses rayons la totalité de l'Empire; d'autre
part la construction de son mausolée dit Eglise des Saints Apôtres, où
son sarcophage allait trôner au centre de l'édifice, tel le Soleil éclairant
tout le Zodiaque symbolisé par 12 faux sarcophages tenant place des 12 divinités
zodiacales. Ces constructions témoignaient assurément de la vénération, voire
adoration, que la population de l'Empire portait à l'Empereur, et en même
temps de la conscience que celui-ci possèdait de sa propre divinité.
-A
Rome, l'ancienne et glorieuse capitale, l'édification de la grandiose basilique
chrétienne du Vatican, commencée vraisemblablement en 322 et terminée en
349 sous Constant, fils de Constantin. Cette église majeure reçut des reliques
dites de Pierre, le premier des Apôtres selon la Tradition, et devint dès après
l'achèvement des travaux un lieu de pélerinages très fréquenté (9). La basilique vaticane était située hors des Murs d'Aurélien, sur
l'emplacement d'un cimetière et du temple de Cybèle et d'Attis; les prêtres du
culte métroaque y vaticinaient. La vie de Pierre relève principalement du "Liber
pontificalis" hagiographie tardive qui ne possède aucun caractère historique
fondé. Le Vatican devait devenir plus tard le centre du Christianisme
romain.
-A
Jérusalem, la construction d'une basilique à l'emplacement du temple d'Aphrodite
élevé par Hadrien en 135 à Aelia Capitolina. Par celle-ci, Constantin
officialisait l'appropriation chrétienne de la Septante, selon le principe: "Je
suis leur chef, il faut que je les suive"; il créait virtuellement les Lieux
Saints chrétiens en permettant aux futurs évangélistes, copistes, correcteurs,
glossateurs etc... , de situer en Galilée la vie terrestre de leur
Sauveur.
En définitive, Constantin, par ses principales
actions de bâtisseur, créa pour une durée indéterminée la géographie religieuse
du Christianisme catholique étendu à l'Empire dans sa totalité.
Mais son action dans le
domaine doctrinal et "spirituel" fut encore bien plus
décisive.
Il fut incontestablement le
Chef des chrétiens; chaque évêque reconnut son autorité et chaque Concile se
tint sous sa direction
effective:
-
d'abord, le Concile d'Arles en 314 réuni pour tenter, en vain, de mettre fin au
schisme donatiste;
-
ensuite, le Concile oecuménique de Nicée, rassemblant 318 pères venus de tous
les horizons de l'Empire pour résoudre la question arienne et définir la
doctrine unique d'une Eglise Unique,Catholique et Apostolique, doctrine
condensée en un "Credo" récité encore par les Chrétiens
d'aujourd'hui.
Ce Concile,réuni au
palais impérial de Nicée le 20 Mai 325, dura plusieurs semaines et se termina
vraisemblablement le 19 Juin (ou 25 Juillet). Non seulement Constantin
présida la séance inaugurale, mais aussi tous les débats relatifs à des
questions doctrinales; les autres sessions se placèrent sous la direction
d'Ossius de Cordoue, son homme de
confiance.
Les décisions du Concile furent
diffusées par une lettre de Constantin, dans laquelle il exprimait sa joie:
"pour l'unité retrouvée de la foi" (10).
Les décrets du Concile reçurent force de loi d'Etat. Ainsi
s'établissait le Régime de "Chrétienté" avec son interpénétration toujours plus
étroite de l'Eglise et de l'Etat (10) L'Eglise devenait l'Administration religieuse
de l'Empire; catholique, puisque son action s'exerçait sur toute l'étendue du
territoire romain; apostolique,puisqu'elle prétendait à un lien direct avec
son Sauveur autrefois incarné. L'Eglise était une organisation de langue grecque
ayant sa capitale à Constantinople,et non plus à Rome; les Actes du Concile
de Nicée furent traduits du grec en latin avec deux siècles de retard, en 525
environ par Denys le Petit. En tant qu'Administration impériale, l'Eglise n'agissait
que pour le bien de l'Empire, c'est-à-dire le renforcement de son unité autour
de la personne de Constantin, dont elle propageait le culte.
Il s'instituait donc une religion du Pouvoir servie
par les Chrétiens, qui identifiaient totalement leur Sauveur avec Constantin-Christ,
suivant la doctrine exprimée par le "Credo" nicéen. Cette doctrine établissait,
d'emblée, l'unicité de Dieu, ce qui constitua à l'époque une véritable révolution
politico-religieuse.L'Empereur Auguste, en son temps, se réclamait d'une origine
vénusienne en tant que membre de la famille des Julii, mais aussi d'une ascendance
directe apollinienne par sa mère Attia. Cependant, d'autres Romains pouvaient,
en même temps, se prévaloir d'une autre origine "divine" : Mars, Hercule, Nérée,
Aphrodite etc... Auguste, quoique d'origine "sacrée" et Pontifex Maximus, n'était
pas le seul descendant "divin", et sa sacralité n'était confirmée qu'éventuellement
par le Sénat romain, après sa mort. L'unicité du dieu nicéen effaçait d'un coup
toutes les divinités antérieurement adorées pour ne laisser subsister que le
Dieu-Père de Constantin, qui sur terre, en tant qu'Empereur, constituait son
seul Christ. Plus précisément, Constantin, statufié en dieu vivant, représentait
la nouvelle incarnation du Fils Unique du Père Unique, après une première vie
terrestre en un temps indéterminé; venu pour sauver les Chrétiens des menaces
mortelles de Dioclétien et les établir en un état de paix et de bonheur, comblés
de richesses, triomphant de leurs oppresseurs par l'officialisation de leur
culte chrétien, et une prochaine "révolution culturelle". Dans sa première vie
terrestre, le Sauveur chrétien, vivant en Palestine selon les indications de
la Septante, répondait au nom de Jésus; celui de Seigneur Jésus- Christ signalait
clairement l'identification de ce Sauveur et de Constantin.
De fait, après Constantin, aucun Empereur à Constantinople
ne se verra "divinisé" de son vivant; bien plus, à partir de Justinien (527
-565), certains documents officiels firent apparaître le visage du Christ en
image clipéata entre le portrait de l'Empereur et celui de l'Impératrice. L'Empereur
sera déclaré "Ami très cher du Christ"; le Christ sera désormais l'hypostase
céleste de Constantin et sera salué comme "Empereur céleste et Seigneur de Majesté"
par le dernier Concile oecuménique tenu à Constantinople en 869.
4 L'Eglise
romaine. après la dynastie constantinienne (364 -754)
Certes, outre la condamnation
d'Arius, la doctrine nicéenne fit l'objet de discussions et de transactions.
Concernant la première incarnation du Sauveur, les 318 pères furent dans
l'impossibilité de dire où et quand Il s'était fait homme, où et comment Il
avait souffert, où et comment Il était mort. Cette mort n'était même pas
mentionnée, mais sa résurrection, au troisième jour, rappelait trop visiblement
la résurrection d'Attis (Papa), célébrée chaque année le 25 Mars après trois
jours de deuil, depuis environ six siècles à Rome et dans l'Empire, pour ne pas
remarquer une influence exercée par l'ancienne et glorieuse
capitale.
Enorgueillie par une domination
multiséculaire du Bassin méditerranéen, allant même très au-delà, l'Urbs ne
s'était pas encore convaincue de sa situation de ville-musée; évincée en
Occident, depuis le début du IVème siècle, par Milan pour des raisons de
stratégie dans la lutte contre les Barbares; bientôt dépassée par la richesse de
la nouvelle capitale impériale: Constantinople. Rome redeviendra capitale d'un
modeste Etat, l'Etat Pontifical, à sa création par Etienne II, quatre siècles et
demi plus tard. Cette ville-musée sera pillée, saccagée, détruite pour partie,
plusieurs fois au cours des Vème et VIème siècle, notamment du fait des armées
des Wisigoths, Vandales, Ostrogoths, tous chrétiens, mais ariens, évangélisés
après Nicée par un évêque nommé Wulfila, chassé par les Chrétiens orthodoxes,
réfugié dans les régions lointaines occupées par ces
Barbares.
Il fallut donc 450 ans pour que
l'Evêque de Rome, primus inter pares, puisse imposer, à travers des événements
tragiques, sa prééminence à tous les évêques italiens, et progressivement,
au-delà, aux évêques de la Gaule, de la Bretagne, de l'Allemagne et de l'Espagne
non musulmane; à une Europe occidentale, reste très appauvri de l'immense Empire
romain, dont l'Eglise chrétienne constantinienne, dite catholique, avait été
l'agent unificateur. Catholique, elle ne le sera plus jamais; cet adjectif
traditionnellement accolé à son nom manifestera une volonté de puissance
toujours active, et
dangereuse.
L'histoire de l'institution
de la prééminence romaine fut concrétisée principalement par trois évêques:
Ambroise, Léon 1er., Grégoire 1er. dit le Grand. Mais avant d'évoquer l'action
de ces trois personnages, il convient de caractériser la pratique religieuse
chrétienne de ces quatre siècles et demi.
Cette
pratique fut d'abord, au nom du nouveau Dieu unique, hypostase céleste de
l'Empereur Constantin, la persécution meurtrière des gréco-romains attachés
encore à leurs cultes ancestraux, qui les détournaient momentanément du culte
impérial. Certes, l'Evêque de Rome, ni aucun autre évêque en Occident, n'eut à
sa disposition comme le Patriarche d'Alexandrie une armée d'envlron 70.000
cénobites ou moines, terrés habituellement dans les déserts égyptiens,mais prêts
à se lancer sur ordre du Patriarche contre les temples "païens", et à martyriser
nobles ou citoyens ordinaires perdus dans leurs habitudes ancestrales.
Cette
"révolution culturelle", en Occident et en Orient, fut beaucoup plus importante
et sanglante que les trois "grandes" (?) persécutions anti-chrétiennesde Dèce,
Valérien et Dioclétien.
L'assassinat d'Hypatie en 415, à Alexandrie,
condensa l'horreur de cette manifestation de la foi chrétienne éclairée des
feux d'incendies de bibliothèques ou d' habitations, ponctuée de meurtres encouragés
par les évêques, quelques Pères de l'Eglise. Ces débordements sans nom entraînèrent
un obscurcissement des esprits, une haine de la raison, à tel point que la célèbre
Académie d'Athènes, fondée par Platon au IVème siècle avant notre ère, fut fermée
par Justinien en 529; les philosophes néo-platoniciens durent se réfugier en
Perse pour rester en vie. Le christianisme se montrait dans la nudité de la
religion du Pouvoir,balayant tout ce qui pouvait entraver l'exercice entier
de celui-ci. Dieu était à son origine, tout Pouvoir venait de lui, chaque Chrétien
gagnait son Ciel en obéissant fidèlement à ses Maîtres, y compris les évêques
et prêtres que Dieu avait investis de son autorité suprême.
Cette folie
augmentait les terreurs provoquées par les raids sanglants des barbares
gothiques, les guerres de reconquête italienne de Justinien après la disparition
de l'Empire occidental, les coups portés par les Lombards à partir de 568
...etc..
Qui savait à qui se fier? Les
pratiques religieuses chrétiennes marquèrent en compensation le triomphe de la
superstition, incarné dans le commerce des reliques de martyrs, et celui des
reliques de la "vraie Croix", rapportée par la légende, tout à fait faussement,
à la mère de Constantin, l'Impératrice Hélène. Cette "vraie Croix", détaillée à
prix d'or, que personne n'avait jamais vue, inventée par des moines
falsificateurs abusant outrageusement de la crédulité publique, possèdait le
pouvoir miraculeux de se renouveler d'elle-même, après chaque prélèvement. Les
orfèvres créèrent les reliquaires les plus surchargés d'or et de pierreries pour
abriter un copeau de cette croix, premier élément du "trésor" des églises,
abbayes et chapelles où l'on conservait aussi, suivant les circonstances, outre
les os de martyrs ou des Rois Mages, le prépuce de Jésus Christ, son cordon
ombilical, la cire de la chandelle allumée à sa naissance, un peu d'eau du
Jourdain utilisée pour son baptême... !
Les peurs des foules, leur besoin d'une sécurité
d'autant plus forte que ces peurs étaient plus vives, les "fidélisaient" toujours
davantage, et les conduisaient en troupeaux moutonniers non seulement dans les
églises pour l'exercice de leurs rites cultuels, mais dans la vie quotidienne
placée par la magie de la confession sous le regard curieux et avide des prêtres.
Ceux-ci disposaient du pouvoir fabuleux d'obliger leur Dieu, le "tout puissant",
à pardonner à ses enfants adoptifs leurs manquements graves ou légers à Ses
commandements lus et commentés par son clergé. La religion chrétienne augmentait
les besoins de sécurité du peuple, et, simultanément, apportait les remèdes
à ses détresses, fabriquait les barrières par lesquelles elle règlementait le
cours de la vie de chacun, pour le plus grand bien matériel des institutions
ecclésiales; celles-ci capitalisaient une part importante de la richesse de
l'Occident, en contre-partie de leurs prières. L'Eglise chrétienne occidentale
possèdait de fait, à l'époque, un pouvoir totalitaire et théocratique, dont
la seule justification résidait dans les réponses apportées par l'institution
aux peurs innées des hommes, à leurs désespoirs, à la crainte perpétuelle de
perdre la vie.
C'est dans ce contexte général
psycho-sociologique qu'il convient d'examiner l'action déterminante des trois
évêques précités:Ambroise, Léon Ier. et Grégoire Ier. dit" le Grand".
Ambroise
(339 -397)
Ambroise (Ambrosios, le divin) fut en son temps
un être d'exception. Il était né dans une famille clarissime, très ancienne,
de la noblesse sénatoriale romaine, les Aurelii, liée aux castes les plus importantes.
Il était petit, chétif, maladif, ce qui l'obligea,dans son orgueil d'aristocrate,
à surmonter ces handicaps par une formation intellectuelle rarement aussi complète;
sa volonté de domination, son appétit de popularité se manifestaient dans son
regard et sa voix, qui lui confèraient une autorité d'autant plus respectée
qu'il était malingre.
Gouverneur de l'Italie du Nord à 30
ans, chrétien disait-on, mais non baptisé, il fut confronté à Milan, son chef-
lieu, mais aussi capitale de l'Empire occidental, aux désordres causés encore
par la querelle arienne malgré le Concile de Nicée; à l'occasion du remplacement
d'Auxence, évêque décédé de la ville, qui avait été arien. Après des péripéties
multiples, Ambroise fut proclamé par le peuple, subjugué par sa maîtrise, évêque
de Milan; l'élection fut confirmée par la Commission épiscopale, seule
compétente, et officialisée après le baptême de l'intéressé, le 1er. Décembre
373. Ambroise s'imposa rapidement comme le représentant des églises italiennes
et devint l'évêque de la Cour impériale, un conseiller particulièrement influent
du fait de sa culture et de son autorité inconstestée. Ses antécédents
familiaux, son orgueil de caste, son éducation le poussaient à considérer comme
des "parvenus" ces Empereurs d'Occident et d'Orient, bien que généraux habiles,
favorisés de la Victoire.
La mort de
Valentinien 1er. en 375, lui donna la possibilité d'exercer sur son fils et
successeur, Gratien, un adolescent, une influence considérable, par laquelle il
obtint de lui en 382 l'abandon du titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire la
désacralisation de l'Empereur. Ambroise eut l'habileté de ne pas reprendre le
titre lui-même, mais il plaçait directement Gratien sous sa direction; celà
constituait une manière de rappel à l'ordre: dans l'Empire romain, la suprématie
appartenait toujours, non pas aux militaires "parvenus", mais aux membres des
anciennes familles nobles sénatoriales.
Cette
sorte de revanche sur le destin se renouvela avec Théodose 1er.(379-395), que
Gratien avait nommé Empereur d'Orient en 379, après la mort de son oncle Valens
dans la déroute d'Andrinople en 378. Théodose était un général non seulement
victorieux, mais dont l'autorité à Constantinople n'était pas contestée. Durant
ses séjours à Milan, Théodose resta généralement sourd aux instances d'Ambroise,
qui se drapait dans les vêtements du "prophète" de Dieu, menaçant
de
s'adresser à l'Empereur, non pas dans son palais, mais en public dans l'église.
Toutefois, son impérieuse passion de domination, l'envie de plier à sa volonté
le Maître du Monde, le poussèrent à commettre des imprudences, à manifester une
maladroite intransigeance, qui lui fermèrent l'accès à l'amitié de
Théodose.
Il fallut l'affaire du génocide de Thessalonique en 390 pour
obliger l'Empereur, revenu à Milan, à faire publiquement pénitence aux fêtes de
Noël, à s'agenouiller en public devant Ambroise, et reconnaître ainsi que la loi
"divine" dictée par l'évêque s'appliquait à chacun, fut-il le Maître de
l'Empire.
Cette deuxième victoire d'Ambroise
préfigurait clairement les exigences de Grégoire VII à Canossa, en 1077, se
présentant comme le seul vicaire du Christ, désigné pour nommer princes, rois et
empereurs, du fait de son autorité "sacrée" et de son infaillibilité. Quelques
auteurs ont vu dans Ambroise le premier théoricien du Saint Empire romain;
Grégoire VII, fréquemment, a invoqué l'exemple de l'ancien évêque de
Milan.
Léon
1er
Nous avons déjà consacré à Léon 1er, évêque de
Rome de 440 à 461, quelques développements à propos de la date de Pâques, et
de la romanisation du temps chrétien. Il nous faut insister sur le fait que
Léon 1er. fut, certes, le Chef véritable de la Ville à laquelle il épargna une
invasion des Huns en 453; mais surtout, le premier évêque à s'intituler Pontifex
Maximus, titre impérial abandonné par Gratien en 382. Ce titre ne fut jamais
réclamé par un autre évêque; Léon 1er. avait obtenu une déclaration formelle
de la suprématie de Rome à l'encontre de Constantinople et de ce fait à l'encontre
d'Antioche, Jérusalem, Alexandrie, sièges de Patriarcats. L'Urbs, avait-il démontré,
l'Urbs, ville chrétienne, était la première et glorieuse capitale de l'Empire
et devait son existence de ville chrétienne non seulement aux reliques de Pierre,
Paul et autres martyrs, mais d'abord aux héros mythiques Romulus et Remus, sans
lesquels elle ne serait pas. C'est Léon 1er. qui, par son attitude de très grande
fermeté, et son souci de conserver un passé glorieux, contribua, plus que Denys
le Petit au siècle suivant, à fonder la chrétienté de la Ville dans l'illustre
passé romain, transformant l'Histoire du christianisme en un chapitre de l'Histoire
romaine. A partir donc de Léon 1er., Rome devint la capitale de la chrétienté
occidentale et son Evêque succèda aux "divins" Empereurs du temps jadis dans
le rôle d'intermédiaire entre le Dieu unique, origine du pouvoir, et son peuple
élu.
Grégoire
le Grand
Grégoire fut évêque de Rome de 590 à
604. Mgr. Duchesne lui consacra les ultima verba de son "Eglise au VIème siècle"
pour saluer "son éclatante vertu, sa rare intelligence, son profond bon sens" (11). Comme Ambroise, auquel Grégoire fait beaucoup penser, il était
issu d'une famille noble romaine, très riche, et qui avait, dit-on, déjà fourni
un évêque à Rome. Comme Ambroise, il faisait carrière dans la haute
Administration impériale, et campait un jeune Préfet de la Ville très remarqué.
La mort de son père, Gordien, le plongea dans une grande détresse morale et le
conduisit à se consacrer entièrement au service divin en se retirant du monde.
Grégoire donna ses domaines en Sicile pour y fonder six monastères; il en créa
un septième à Rome en s'enfermant dans sa maison avec quelques compagnons. Tant
de renoncement devait attirer sur lui l'attention de son évêque. .Pélage II (579
-590), auquel il succèda, l'envoya à Constantinople en qualité d'apocrisaire
pour représenter le Siège romain.
Dans l'exercice de ses fonctions épiscopales,
à la plus haute charge religieuse dans tout l'Occident, Grégoire connut des
débuts prometteurs avec la conversion de l'arianisme de Recarède, roi des Wisigoths,
à Tolède en 587; conversion connue à Rome en 591. En outre, les rois mérovingiens
en Gaule dotaient richement les églises,..... etc...
En tant qu' Evêque de
Rome, Grégoire, comme tout évêque de la Ville depuis la fin du Vème siècle,
était responsable de l'Administration municipale et son Trésorier. Il participa
avec les généraux à la défense de la Ville contre les Lombards et signa une
trêve avec ceux-ci en 595. Pour faire face à ces diverses activités civiles, le
Siège épiscopal de Rome disposait alors de revenus importants provenant d'un
patrimoine très étendu, en Sicile, Sardaigne, Afrique du Nord, et même en
Gaule.
Outre sa gestion rigoureuse des
patrimoines de son évèché, deux faits principaux caractérisèrent l'action de
Grégoire:
- Il fit siennes les
prétentions antérieures de Léon 1er. à une primauté sans conteste de Rome, une
primauté d'honneur à l'encontre notamment du Patriarche de Constantinople,
qui voulait être nommé, par l'Empereur d'Orient, Patriarche oecuménique.
- Grégoire
se désigna comme le "Consul de Dieu".Ce titre s'ajouta à celui de Pontifex
Maximus accaparé par Léon 1er; il confirmait le droit de regard de Rome sur
toutes les Eglises d'Occident, mais bien plus, il théorisait le "gouvernement
universel des âmes", que tout Pape romain, après le schisme de 1054, voulut
réaliser.
Bibliographie
(1) Cf.
"Dictionnaire historique de la Papauté" sous la direction de Ph. Levillain chez
Fayard
-Paris. retour
Article
"Les Etats pontificaux" page 628.
(2) Cf. F.Decret "Le christianisme en
Afrique du Nord ancienne" Editeur : Le Seuil
Paris retour
(3)
Cf. Mme Luce Pietri "La persécution sous Dioclétien" in "Aux origines du
christianisme" -Page
462
Textes présentés par P.Geoltrain chez Folio Histoire
-Paris retour
(4)
Cf. Collection B.T.T. 2 - "Le Monde latin antique et la Bible" P.Petitmengin
"Les plus anciens manuscrits de la Bible
latine"
Chez
Beauchesne -Paris Pages 89 à
127. retour
(5)
Cf. "Dictionnaire de l'Antiquité" -Université d'Oxford Editeur Robert Laffont
-Paris
Article
Pontifex -Page
800 retour
(6)
Cf. A.J.Festugière "La révélation d'Hermès Trismégiste" Editeur Les Belles
Lettres - Paris - Tome l -Pages 324 et
suivantes retour
(7)
Cf. G.Alberigo "Les Conciles oecuméniques" - Editeur Le Cerf - Paris Tome l -
L'Histoire - Page
23
"Le
Pontifex Maximus sera l'image du souverain qui passera dans
le christianisme" retour
(8)
Cf. G.Alberigo -"Les Conciles oecuméniques" - Editeur Le Cerf - Paris - Tome l -
"L'Histoire" - Page
21 retour
(9)
Cf. J.Carcopino "Etudes d'histoire chrétienne" - chez Albin Michel -
Paris "Les fouilles de Saint-Pierre" - Pages 97 à
247.
En ce
qui concerne le chrisme, lire avec réserve pages 190 et 191. Carcopino dans ses
" Etudes " est souvent victime de ses coyances; il reconnait bien les faux mais
juge comme s'ils étaient
vrais. retour
(10)
Cf. G.Alberigo "Les Conciles oecuméniques" - Editeur Le Cerf - Paris
"L'histoire" - Tome l - Pages 19 à
49 retour
(11)
Cf. Duchesne - "L'Eglise au VIème siècle" - Editeur de Boccard -
Paris retour